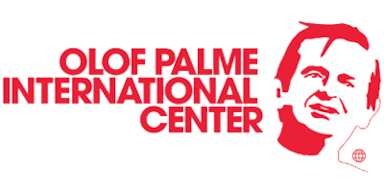Les organisations non gouvernementales Juristes pour le Renforcement et l’Application de Loi dans le secteur de l’Environnement (JURISTRALE), SOS Nature (SOSN) et Centre National d’Appui au Développement et à la Participation populaire (CENADEP) ont, en partenariat avec le World Resources Institute (WRI), dévoilé les résultats de deux études qui ont porté respectivement sur la « Participation des parties prenantes aux processus décisionnels dans le secteur forestier : état des lieux, défis et opportunités pour une gestion forestière participative et durable en République Démocratique du Congo » ainsi que sur la : « perception du bien-être par les Communautés Locales et les Peuples Autochtones dans les provinces de l’Équateur, de l’Ituri, du Kongo-Central et de la Tshopo en RDC. Ces résultats présenté ce jeudi 24 juillet, à Kinshasa, soulignent notamment une réalité préoccupante : la participation des acteurs dans les décisions forestières est souvent plus théorique que pratique.
Le Professeur Cléo Mashini Mwatha , directeur général de JURISTRALE, a clairement indiqué les conclusions de cette recherche, éclairée par le cadre de l’Indicateur de Gouvernance Forestière (IGF). Selon lui : « Les conclusions de cette étude révèlent une situation ambivalente. Si la RDC a fait des avancées significatives en adoptant un cadre juridique qui reconnaît formellement le droit à l’information et à la participation des parties prenantes, l’effectivité de ces droits reste un défi majeur. Les mécanismes de consultation sont souvent perçus comme théoriques, l’accès à l’information est limité, et la voix des groupes vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes, peine à être pleinement entendue et prise en compte dans les décisions qui les impactent directement. »
Des chiffres éloquents appuient cette affirmation : sur 1 462 personnes consultées, 41,1% estiment que ces mécanismes sont théoriques et rarement utilisés, et 26,61% les trouvent limités ou exclusifs. Seuls 3,15% des enquêtés reconnaissent l’existence de mécanismes divers et inclusifs. Les mécanismes de gestion des plaintes et recours sont jugés quasi-inexistants (30,1%) ou inefficaces (44,9%).
Par ailleurs, il existe un déséquilibre d’accès à l’information selon les groupes : 28,52% estiment n’avoir pas accès à l’information ; seules 2,53% estiment avoir accès à des informations complètes et compréhensibles, tandis que les 68,95% restants estiment que l’information est souvent incomplète et limitée à certaines catégories. S’agissant de la participation de la femme, 39,1% estiment que leur participation est marginale. Enfin, s’agissant des CL/PA, seuls 5,06% reconnaissent une implication totale des communautés locales.
La seconde étude, menée par SOS Nature et CENADEP, selon l’approche BNS, a porté sur la perception du bien-être par les CL et PA dans les provinces de l’Équateur, de l’Ituri, du Kongo-Central et de la Tshopo a révélé, que le taux de possession des biens ou d’accès aux services de base est très bas parmi les ménages enquêtés. La grande majorité de ménages (83%) a un taux de possession de moins de 50%.
Seuls 17% de ménages ont atteint un taux de possession d’au moins 50%. Le niveau de possession des nécessités varie significativement parmi les provinces concernées, avec le Kongo Central étant la province ayant le taux de possession le plus élevé, et l’Équateur le taux le plus bas. Ce résultat corrobore avec celui de l’indice de bien être qui atteint son niveau le plus élevé auprès des ménages se trouvant dans la province du Kongo central 44,7 et le plus bas dans celle de l’Équateur 30,4. Cela va de pair avec les ménages ayant les proportions les plus élevées de détention des biens et d’accès aux services nécessaires.
Ces études s’inscrivent dans un contexte où les initiatives pour renforcer la participation des communautés sont de plus en plus cruciales. En 2023, Forests People Climate (FPC) a d’ailleurs élaboré une stratégie pour le bassin du Congo, visant à consolider les voix de la société civile et à améliorer les droits fonciers et forestiers des peuples autochtones. FPC prévoit d’actualiser ces données d’ici 2030, en se penchant notamment sur le bien-être perçu par les communautés locales (CL) et les Peuples autochtones (PA), ainsi que sur le niveau d’implication des parties prenantes dans les délibérations politiques et la prise de décision.
Les rapports présentés lors de l’atelier ont été validés avec amendements par le Conseil Consultatif Stratégique. En guise de recommandations, les acteurs de la société civile ont appelé les décideurs politiques et les administrations à renforcer le cadre juridique et institutionnel, à promouvoir une véritable culture de participation, à allouer des ressources financières, humaines et logistiques adéquates, et à mettre en place des mécanismes efficaces de prévention et de résolution des conflits.
Quant au secteur privé, il est exhorté à adopter une politique de participation proactive, à impliquer les parties prenantes à toutes les étapes de planification et à communiquer de manière transparente sur les impacts environnementaux et sociaux, ainsi que sur les plans de gestion forestière.
Albert MUANDA