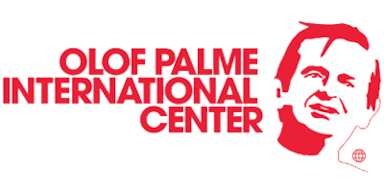Des flammes aux sabots: en RD Congo et au Togo, les mangroves, pourtant reconnues pour leur importance écologique, sont aujourd’hui sous une pression croissante. En 2024, un rapport de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) donnait l’alerte : plus de la moitié des mangroves mondiales pourraient disparaître d’ici 2050 si aucune mesure urgente n’est prise.
Ce constat trouve un écho particulièrement fort sur le continent africain, où la situation est déjà critique. L’étude The State of the World’s Mangroves publié en 2024 par Global Mangrove Alliance (GMA), estime que l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale abritent environ 22 802 km² de mangroves, soit 15,5 % du total mondial. Pourtant, ces écosystèmes essentiels sont en chute libre. L’Afrique de l’Ouest, par exemple, a perdu entre 25 % et 50 % de ses mangroves au cours des 30 dernières années, indique cette étude.
Vitales pour la biodiversité tropicale et la régulation du climat, les mangroves sont gravement menacées par des activités humaines dévastatrices : torchage pétrolier en RDC, transhumance bovine au Togo. Des sabots dans les marais, des flammes dans les arbres, les mangroves tombent. Mais pas sans défense.
La transhumance, un massacre silencieux des mangroves
Dans un coin du littoral togolais, là où l’eau salée rencontre l’eau douce, s’étend un écosystème fragile mais vital : les mangroves. Petit pays d’Afrique de l’Ouest enclavé entre le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso et l’océan atlantique, le Togo totalise, depuis 2007, quatre sites Ramsar[1] couvrant 1 210 400 hectares dont le bassin de la rivière Oti-Mandouri au nord, et la zone côtière au sud.
Alarmant. Mais derrière cette reconnaissance internationale, c’est un effondrement qui passe presque inaperçu. Sur le littoral sud-est du Togo, les mangroves, véritables remparts naturels contre l’érosion côtière et refuges de biodiversité, sont en déclin alarmant. En 1998, elles s’étendaient encore sur près de 1 000 hectares. Mais en 2020, il n’en restait que 112[2] hectares, selon un rapport de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), soit plus de 85 % de superficie de mangrove détruites en deux décennies.
Aujourd’hui, seules de petites franges discontinues de palétuviers subsistent: Rhizophora racemosa et Avicennia germinans. Elles sont isolées par endroits, « atteignant rarement 10 mètres de large le long des berges de ces cours d’eau», rappelle ce rapport. Cette dégradation rapide menace non seulement les écosystèmes côtiers, mais aussi les moyens de subsistance des communautés locales. Dans un contexte de changement climatique et de pression humaine croissante, le recul des mangroves togolaises sonne comme un avertissement, encore largement ignoré.
Et pourtant. Tout semblait réuni pour faire vivre et survivre les mangroves. La mangrove togolaise bénéficie d’un climat subéquatorial, avec deux saisons de pluies et deux saisons sèches. Les zones humides, riches en biodiversité, se concentrent dans les préfectures des Lacs dans les cantons d’Agouégan, Aklakou et Glidi) et de Vo (dans le canton d’Agnron Kopé).
Ces zones humides, bien que ne représentant que 4% de l’écosystème togolais, selon la Direction des ressources forestières, jouent un rôle écologique primordial. Elles agissent comme des puits de carbone, séquestrant des quantités de CO2 faramineuses, tout en offrant des services écologiques et économiques de grande envergure aux communautés côtières.
Le territoire est traversé par trois grands cours d’eau: le Mono, le Haho et le Zio. Il est bordé par des plans d’eau comme le lac Togo, le lac Boko ou encore la lagune d’Aného. Un réseau dense, vital, un environnement idéal pour les mangroves. Mais elles souffrent.
Parmi les pressions silencieuses qui les fragilisent et les maintiennent en sursis, la transhumance incontrôlée. Chaque année, des troupeaux traversent les zones humides à la recherche de pâturages. Ils piétinent les jeunes plants, brisent les racines, fragilisent les sols. Les palétuviers, déjà menacés, n’y résistent pas. A Afidenyigban, victime d’un déséquilibre ancien et difficile à contrôler, la mangrove endure, à Agouégan, la pression du désir d’une vue imprenable sur la lagune.
Le rêve d’une vue… contre les mangroves
Le Togo semble connaître un répit dans l’exploitation massive des mangroves pour le bois. Mais ce calme apparent masque de nouvelles formes de pressions. À Agouégan, dans la région des Lacs, au silence des tronçonneuses qui arrachent les palétuviers, ces galeries dressées entre terre et eau, s’enracine une autre menace : une vue imprenable sur la lagune. La zone d’Agouégan fait partie du site Ramsar des zones humides du littoral.
Photo capture de cran d’Agouégan
Pour une belle vue. Ici, les habitants n’arrachent pas les palétuviers pour le bois, mais pour dégager l’horizon et profiter d’un panorama direct sur le chenal. Ils abattent les mangroves (qu’ils perçoivent comme une barrière entre leurs habitations et l’eau) comme on tire un rideau, espérant ouvrir leur horizon sur le paysage lagunaire. « Pour une belle vue, ils sacrifient ce qu’il reste des mangroves », déplore Komi Yawo, Coordonnateur adjoint du projet WACA-Togo (Projet d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest).
Interrogé sur cette situation, le Colonel Piwelon Bakah, Point focal togolais de la Convention AEWA (Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie), Chef session Zones humides à la Direction des ressources forestières propose un plan de gestion des zones côtières qui doit s’articuler autour de la reconstitution du couvert végétal. « Si les mangroves sont retirées d’un endroit, elles doivent être restaurées ailleurs, pour éviter leur disparition totale », insiste-t-il. Sauf que « les jeunes plants replantés sont aussitôt détruits », regrette Komi Yawo.
Les mangroves composées de palétuviers séquestrent une grande quantité de carbone. Or comme le souligne Professeur Kudzo Guelly de la Faculté des Sciences de l’Université, « la disparition de ces espèces aggraverait le problème climatique, car la capacité de séquestration du carbone diminuerait ».
12 fois plus de CO2. En effet, les zones humides agissent également en tant que puits de carbone, séquestrant d’importantes quantités de CO2. Mais lorsqu’elles sont recouvertes de mangroves, leur capacité à capter le dioxyde de carbone est décuplée, nous a expliqué Colonel Piwelon Bakah, « Les mangroves séquestrent 12 fois plus de CO2 que les zones humides non couvertes ». Un argument scientifique qui renforce l’urgence de protéger cet écosystème face aux menaces de dégradation.
Les mangroves constituent à la fois une barrière naturelle contre l’érosion côtière, un sanctuaire pour la biodiversité: elles hébergent une faune variée et servent de refuge pour de nombreuses espèces, des crabes aux petits poissons. Contribuant à la lutte contre le changement climatique, elle protège les communautés locales en amortissant l’impact des tempêtes. «Sa dégradation menace les équilibres écologiques et les moyens de subsistance des populations Protéger la mangrove, c’est préserver la vie, les ressources et notre avenir commun»[3], lit-on sur la page Facebook du ministère gabonais de l’environnement, de l’écologie et du climat.
En plus de leur rôle climatique, les mangroves sont aussi le théâtre d’activités génératrices de revenus pour les communautés riveraines : récolte de champignons, culture de miel, entre autres. « Les mangroves ne sont pas seulement un élément de biodiversité ; elles participent à l’économie locale en offrant des opportunités de subsistance », a rappelé le Commandant Komlan Togbossi, Point focal togolais de la Convention Ramsar sur Zones humides.
Sabot. Cette quête esthétique, pourtant, ne laisse aucun répit à l’écosystème. Si les campagnes de sensibilisation freinent l’ampleur des destructions, la régénération des mangroves reste fragile. Là, ailleurs, cette régénération ploie et se bat sous les assauts des sabots.
Nous sommes en 2025, et la situation se dégrade davantage. Même si aucun chiffre récent n’est encore disponible, l’état dégradant continu des mangroves inquiète plus d’un. Ce phénomène est actuellement aggravé par des facteurs assez variés parmi lesquels la transhumance. Cette dernière reste l’un facteurs clés étonnamment absent de la majorité des rapport et études. Ce phénomène, bien qu’anthropique, est devenu presqu’un angle mort préoccupant dans la plupart des diagnostics liés aux mangroves.
Pourtant, sur le terrain, les signes sont là. Le passage répété des troupeaux, la destruction des jeunes pousses de palétuviers, la pression exercée sur les sols et les ressources des zones humides contribuent à fragiliser un écosystème déjà sous tension.
Sur le chenal, les troupeaux piétinent l’avenir des mangroves. Très souvent, pendant les saisons sèches, les prairies des mangroves sont transformées pâturages naturelles fortement utilisés par les bouviers sédentaires ou nomades.
Le pâturage des bovins émerge comme l’une des causes majeures de l’échec des efforts de restauration des mangroves. Les bovins dévastent les jeunes palétuviers nouvellement plantés et infligent des dégâts irréparables. Le piétinement des propagules par les troupeaux « occasionne le tassement du sol hydromorphe » et la mort des jeunes plants, souligne un rapport accablant de l’UICN.
Selon la FAO[4], la transhumance est responsable de près de 40 % des échecs de restauration des mangroves au Togo.

Récurrent dans la préfecture des Lacs notamment à Adamé, Aneho, Glidji ou à Zalivé, le phénomène est plus flagrant à Afidenyigban où les entreprises de restauration ont été maintes fois anéanties à cause du piétinement des propagules le long des Bassins des Lacs Boko, Zowla et Hinterland par les bovins.
Dans le Vo, les mangroves sous le poids des sabots
A Afidenyigban, petit village de la commune de Vo 1, de fréquents visiteurs sèment le désarroi à chacun de leur passage. Des bœufs à la recherche de leur pitance journalière, piétinent l’écosystème et détruisent de leurs sabots des palétuviers.

Aux pieds du village, coule un lac : Zowla. Ses petites ondulations ce samedi 1er mars 2025 donnent l’aspect d’un long drap gris que soulève un léger vent. De ce mouvement ondulatoire régulier, des clapotis qui échouent sur la berge. Sur les rives du fleuve des endroits bordés d’arbustes sauvages. Il y a aussi des endroits arboricoles clairsemés et fangeux. Ils portent certains stigmates. Des traces humaines et animales. « Nous avons raté de peu leur passage », nous dit Bado Yaovi, Trésorier de l’association Civigbozoh. Comité Inter Villages de Gestion des Bassins des Lacs Boko, Zowla et Hinterland.

Les échappées. Dans le cadre du projet WACA, une dizaine de rangées de plantes aquatiques ont été plantées tout au long du bassin Boko-Zowla. L’objectif est de régénérer les mangroves. Mais seules six rangées ont échappé aux dents et aux pieds des bœufs. Lors de leurs passages, les animaux broutent, piétinent, coupent ou détruisent les plantes. Une bonne partie de la flore aquatique est ainsi décimée. Il ne reste qu’une végétation chétive et clairsemée de palétuviers.

« Nous avons reboisé 95 hectares de palétuviers tout au long du lac Boko-Zowla. Un tiers a été détruit. Sur cette portion, la plus grande partie c’est ici à Afidenyigban », souligne Bado Yaovi. La destruction massive des jeunes palétuviers à Afidenyigban, selon Bado Yaovi, est liée à la présence des bouviers. Il avoue avoir découvert l’ampleur du phénomène dans le cadre du projet WACA en 2020. « Peut-être que le problème préexistait avant le projet. Des mangroves ont été plantées sur la période 2020-2023 », fait-il savoir.
Avant 2020, dans ce village, des mangroves n’étaient pas plantées. Mais la nécessité de les planter répondait avant tout à un objectif : favoriser le retour de certaines espèces d’oiseaux dans l’espoir de susciter le tourisme. Les plantes aquatiques attiraient effectivement certaines espèces d’oiseaux. Et d’après le Trésorier de ce comité local, des touristes venus de différents horizons s’y rendaient en grand nombre.
Les plantes aquatiques attiraient bien certains oiseaux. Selon le trésorier du comité local, les résultats étaient ceux attendus. Des touristes venus de différents endroits s’y rendaient en grand nombre
Abri pour une faune marine et terrestre diversifiée, les mangroves servent également de pépinières à de nombreuses espèces de poissons et de crustacés. Certaines, notamment celles composées de palétuviers rouges, participent même à l’avancée du trait de côte vers la mer en retenant les sédiments dans leurs racines. Bien plus que de simples écosystèmes côtiers, les mangroves togolaises remplissent aussi un rôle vital dans la médecine traditionnelle.
Le besoin d’ériger une forêt aquatique est de favoriser la reproduction de certaines ressources halieutiques comme le poisson. Les poissons aiment pondre leurs œufs sous ces plantes aquatiques. Mais la destruction des mangroves entraîne l’avancée du lac. Le commerce de l’extraction du sable lagunaire fait également déborder le lac de son lit engloutissant les rangées de palétuviers.
Des accords bafoués, des identités en tension
A Afidenyigban, un laxisme entoure la gestion de la transhumance. Les bouviers et leurs bœufs saccageurs ne sont visiblement inquiets de rien. Malgré les couloirs de transhumance bien définis et des abreuvoirs construits pour les bêtes.
Dans les préfectures de Vo et des Lacs, historiquement non concernées par la transhumance, celle-ci s’est imposée avec ampleur à la faveur de la pandémie de Covid-19 frappant de plein fouet les populations locales. La sédentarisation de certains bouviers peuls, parfois soutenus par des propriétaires influents, complique encore les choses. Les conflits entre Peuls sédentaires ou nomades et les communautés résidentes se multiplient, entraînant leur lot de victimes. Ils seraient nés de la sédentarisation des bouviers.
D’après le gouvernement togolais, les conflits liés à la transhumance ont causé, en 2020, 12 morts, 1 603 réfugiés et 130 cas de destruction de champs dans le pays.
Cette situation a profondément évolué. Aujourd’hui, les éleveurs se heurtent à une raréfaction des pâturages, à la dégradation des ressources naturelles et à l’épuisement des terres. Or, dans ces régions, le mode de vie des populations repose en grande partie sur ces ressources foncières et naturelles, rendant la question de leur gestion plus que jamais cruciale.
Charte. En 2021, avec l’appui de la Banque mondiale, de l’International development Association (IDA) et du Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF), une charte consensuelle a été écrite pour une transhumance apaisée et sans destruction des mangroves notamment dans la préfecture de Vo. Elle est dénommée Charte du Lac Boko/Zowla et Hinterland et vise à contribuer à la gestion efficace des couloirs de transhumance délimités marqués et scellés, la sauvegarde du patrimoine naturel et la restauration de la biodiversité dans les zones humides des bassins du Lac Boko/Zowla et Hinterland.
Cinq années après la réforme, l’application tarde à être effective. Les bouviers restent réticents et refusent de se plier aux nouvelles régulations. Ce qui alimente ainsi les tensions et rend l’application des mesures de plus en plus complexe. « On a écrit une charte (Ndrl le constat de destruction des mangroves établie par Waca) concernant la gestion du pâturage afin de préserver les mangroves », affirme selon Bado Yaovi
Suite à cette charte, un cadre de concertation entre les bouviers et notabilités des préfectures de Vo et des lacs a été même créé aboutissant à la signature d’un protocole d’accord avec les bouviers. Mais l’avenir des mangroves et des zones restaurées continue de se fragiliser, s’éteignant peu à peu sous le poids écrasant et dévastateur des troupeaux ravageurs. En cause, le non-respect des dispositions mises en place.
L’entêtement. « On a tout expliqué aux mais ils ne respectent pas les règles. On ne sait plus comment faire », peste M. Bado. Les barrières linguistiques rendent les échanges difficiles. « Les bouviers ne comprennent pas notre langue. On communique par gestes », explique-t-il. « Parfois, on recourt aux vrais propriétaires des bœufs qui ne sont pas du milieu », fait-il observer. Alors que, d’après lui, les mangroves sont aussi des êtres vivants qu’il faut préserver.
Les bouviers se voient confier des troupeaux de bœufs appartenant, selon plusieurs sources, à certaines autorités influentes. Ce lien de pouvoir leur donnerait une forme de légitimité, voire un sentiment d’impunité, qui expliquerait leur non-respect de la charte. Ces sources sous anonymat (la transhumance étant une question sensible au Togo) y voient de l’entêtement, voire de la défiance, notamment chez ces éleveurs peuls. Pourtant, ces derniers avaient bien été associés à la signature de la charte, aux côtés des autorités locales, du chef traditionnel, du maire, du préfet et de plusieurs représentants des bouviers.
Face à la mangrove en danger, des mains locales sans moyens
Bado Yaovi ne voit pas les problèmes posés par la transhumance comme une fatalité. « On peut résoudre ce problème si on trouve un milieu propice ailleurs pour les bêtes. Plus les bêtes sont ici, plus elles vont continuer à dégrader les mangroves », suggère-t-il.
Sensibiliser sans relâche tout en montrant les bienfaits et l’importance des espèces végétales. Telles sont, selon lui, les prescriptions pour résorber l’inquiétante dégradation des palétuviers. A travers les actions de sensibilisation, la population locale s’implique activement dans la préservation de la forêt aquatique en participant notamment à la plantation de palétuviers, depuis le défrichage jusqu’à la mise en terre, ainsi qu’aux activités de désherbage. Car, souligne Bado Yaovi, « elle (Ndlr, la population) n’est pas contente de voir les bœufs détruire les plantes et nous alerte sur le passage des bœufs puisqu’elle sait que la disparition des mangroves peut agir sur son milieu de vie ». Cette lutte doit impliquer davantage les autorités, à l’en croire.

Suivi et surveillance. Mais la lutte contre la transhumance ne peut se limiter à la sensibilisation. « Il faut un plan de suivi et de surveillance. Il serait nécessaire de mettre en place une équipe de surveillance composée de riverains, rémunérés mensuellement, et déployés en permanence le long du chenal », propose Komi Yawo, Coordonnateur adjoint du projet WACA-Togo. Toutefois, « cette initiative implique des coûts importants et nécessite un budget conséquent, ainsi qu’une implication active des forces de sécurité », reconnaît-il.
Les mangroves, reconnues pour leur rôle crucial dans l’adaptation au changement climatique, attirent désormais des financements ciblés[5]. Ces écosystèmes, véritables infrastructures vertes, deviennent des leviers stratégiques pour protéger les littoraux menacés. Au Togo, un projet d’une durée de cinq ans est lancé en 2022 au secours de la restauration de l’écosystème de mangrove au Togo. Doté de plus de 4,4 milliards de FCFA, il est financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)[6].
L’attention. Au Togo, l’état alarmant des mangroves a suscité l’attention, non seulement des organisations locales, mais aussi de la communauté internationale, notamment de la Coopération belge. En février 2019[7], face à l’urgence environnementale, le consortium Uni4Coop, réunissant quatre (04) ONG universitaires belges francophones (Eclosio, FUCID, Louvain Coopération et ULB-Coopération), a co-organisé avec Kinomé et l’Université de Lomé un colloque multi-acteurs.
Ce chantier international visait à favoriser les échanges entre ONG, institutions publiques, scientifiques, communautés locales et décideurs du Nord et du Sud, afin de réfléchir collectivement à des solutions durables pour préserver les écosystèmes de mangroves et améliorer la gestion des ressources naturelles.
L’initiative. En juillet 2025, un récent retour sur le terrain, à Afidenyigban, révèle une évolution : « malgré la présence continue des bœufs qui traversent les plantations, les cas de dévastation des jeunes mangroves devenues grandes ont nettement diminué », nous a confié Bado Yaovi. A l’en croire, « le piétinement demeure, mais les jeunes plants devenus grands ne sont plus arrachés comme auparavant ». Une amélioration que certains attribuent à la croissance des jeunes palétuviers, devenus plus résistants au passage du bétail.
Cette situation coïncide avec la mise en place récente des comités locaux de veille chargé de prévenir les conflits entre agriculteurs et bouviers peuls à l’initiative du ministre togolais Général Yark Damehame, en charge de la Réglementation de la Transhumance qui, en mars 2025, a tenu une séance de travail à Vogan dans la préfecture de Vo avec des autorités locales, des forces de l’ordre et de la sécurité, des chefs traditionnels et des communautés d’éleveurs et d’agriculteurs.

Présidé par le chef canton, ce comité intercommunautaire de concertation pour une transhumance apaisée qui a réuni des représentants de la direction préfectorale de l’environnement, de la gendarmerie, des agents de l’ICAT (Institut de Conseil et d’Appui technique, une structure du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique villageoise et du Développement Rural), des producteurs agricoles et des bouviers peuls est un cadre permanent de dialogue pour désamorcer les tensions et encourager une cohabitation harmonieuse dans le milieu.
Un laissé pour compte. Chargé d’alerter, de sensibiliser et d’intervenir en cas de conflit, ce comité les moyens manque cruellement des moyens sur le terrain. « Aucun fonds ne nous est alloué, même pas un minimum pour le fonctionnement ou les déplacements », confie un membre sous couvert d’anonymat. « C’est un comité en l’air, laissé pour compte, alors qu’on nous demande de parcourir les villages, d’alerter et de sensibiliser. Sans aucun moyen matériel ; pas de carburant, rien du tout », déplore-t-il. Et pourtant, ses membres doivent parcourir les villages, observer la situation et agir en médiateurs.
Le 24 juillet dernier, un conflit meurtrier a éclaté à Dakrokonsou (centre du Togo) entre un éleveur peul et un cultivateur, après que des bœufs ont ravagé un champ. L’agression a entraîné la mort d’un agriculteur; des représailles violentes contre le campement peul ont fait plusieurs blessés et des déplacements. Ce drame souligne une fois de plus les tensions récurrentes entre éleveurs transhumants et populations locales.
Face à ces limites logistiques, la pérennité et l’efficacité du comité restent incertaines. Les autorités locales espèrent néanmoins qu’une meilleure organisation et un appui concret permettront de produire des résultats sur le terrain. Pendant ce temps, ailleurs dans la sous-région, les défis sont tout aussi alarmants.

Outre les bœufs, une autre menace silencieuse sévit sur les rives de Zowla : les « mangrovephages ». Il s’agit de petits crabes aquatiques qui sectionnent les jeunes palétuviers. Le phénomène passe souvent inaperçu, les regards étant focalisés sur la transhumance. « Ils coupent les jeunes plantes à la base. Leur action est discrète mais réelle », note Bado Yaovi.
Parfois, c’est le lac lui-même qui devient un danger. Une montée de salinité inhabituelle peut affaiblir les jeunes plants. « Il y a aussi les moments où l’eau est salée. Si l’eau devient très salée, ça agit sur les plants mais ce n’est pas fréquent », indique-t-il. Entre marées et menaces, la mangrove se bat.
Aux côtés du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, de la Sierra Leone, du Bénin, du Nigéria et du Cameroun, le Togo fait partie de l’espace ouest-africain GCLME (Guinea Current Large Marine Ecosystem/Grand Écosystème Marin du Courant de Guinée), l’un des écosystèmes marins et côtiers les plus productifs au monde. Dans cette région, les principaux écosystèmes côtiers, notamment les mangroves, forment un continuum écologique qui dépasse les frontières nationales. Cette réalité transfrontalière appelle à une coopération régionale renforcée pour assurer la préservation et la gestion durable de ces milieux essentiels[8].
La survie des mangroves: une priorité ?
La lutte contre cette dégradation n’est pas qu’une question de conservation : elle inclut également la restauration et la valorisation des mangroves. « La restauration est une phase, mais la valorisation doit suivre. C’est là que nous devons augmenter les opportunités économiques tout en préservant l’écosystème », insiste le Commandant Komlan Toggbossi. La gestion intégrée des zones côtières, qui combine conservation écologique et développement économique, est essentielle pour garantir la durabilité des mangroves.
Risque. Pour le Commandant Komlan Piwelon, cette approche doit prendre en compte le bien-être des populations locales. « Il faut que la restauration des mangroves s’accompagne d’initiatives génératrices de revenus. Sans cette dimension, les efforts de conservation risquent d’échouer », avertit John Gaaglo, Directeur exécutif de l’Ong togolaise pour la Conservation de la Nature dénommée AGBO-ZEGUE ONG.
Les mangroves : des boucliers naturels contre l’érosion des côtes
Par AFD (Agence française de développement)
Bien qu’absolument essentielles pour stocker le carbone, protéger les littoraux et assurer l’alimentation et l’emploi de millions de personnes, les mangroves sont actuellement gravement menacées et leur rôle reste encore très largement sous-valorisé. Pour y remédier, l’Agence française de développement (AFD) soutient depuis plusieurs années des projets de protection et d’intégration des mangroves dans les stratégies mondiales contre le changement climatique..
Face à une crise environnementale sans précédent, les mangroves se révèlent être des alliées cruciales dans la lutte contre le changement climatique. Ces écosystèmes, classés sous le terme de « carbone bleu », se distinguent par leur capacité exceptionnelle à capturer et stocker le carbone, absorbant jusqu’à quatre fois plus par unité de surface que les forêts terrestres. Cette capacité unique en fait des acteurs essentiels pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et freiner le réchauffement climatique.
Les mangroves ne se contentent pas de séquestrer du carbone. Véritables boucliers naturels, elles protègent les côtes contre l’érosion et les tempêtes, renforçant ainsi la résilience des communautés littorales face aux catastrophes climatiques. Elles abritent également une biodiversité incroyable, essentielle à la survie de nombreuses espèces marines comme à l’activité de millions de personnes. Selon un rapport de la Global Mangrove Alliance, 4,1 millions de pêcheurs dépendraient directement des ressources disponibles dans les mangroves. Ce rapport estime également que les mangroves s’inscrivent dans le cycle de vie de près de 600 milliards de crevettes et de poissons, ainsi que 100 milliards de crabes et de mollusques.
Malgré leur importance cruciale, les mangroves sont gravement menacées. L’urbanisation galopante, la pollution, l’aquaculture intensive et les effets du changement climatique exercent une pression insoutenable sur ces écosystèmes. Les données les plus récentes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) indiquent que 50 % des mangroves identifiées sur le globe seraient désormais menacées, 19,6 % sont même classées à haut risque. Selon ce nouvel état des lieux, le changement climatique, à lui seul, menacerait 33 % des écosystèmes de mangroves existants.
Comment expliquer cette situation ? Souvent, le rôle des mangroves reste encore très largement sous-valorisé et leur sauvegarde insuffisamment financée. Dans de nombreux pays, elles ne bénéficient d’aucune stratégie de conservation. Par conséquent, l’absence de financement approprié et de réglementations adaptées empêche de tirer pleinement parti du potentiel des mangroves pour la séquestration du carbone et la protection des côtes.
Source : https://www.afd.fr/fr/actualites/sauvegarde-mangroves-tour-du-monde
Selon le gouvernement togolais, depuis 2022, le partenariat avec le FEM (Fonds pour l’Environnement Mondial) et de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) a permis d’améliorer les conditions de vie de 99 500 personnes vivant dans les communautés côtières, et d’accompagner 100 entrepreneurs (dont 50 % de femmes) dans la mise en place de technologies agricoles adaptées. Foli Bazi Katari, ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières, confirmait que « 1 000 hectares de berges lagunaires … ont été restaurés »[9].
Mais une ombre persiste sur cet effort de restauration : l’absence d’une cartographie actualisée des mangroves.
Un manque de données actualisées : une entrave à la planification
Depuis 2020, le pays ne dispose pas d’études récentes pour évaluer l’état exact des mangroves. Selon des sources, ce manque de données actualisées serait lié à des insuffisances financières pour réaliser des études d’envergure.
Selon le Commandant Komlan Togbossi, la situation sur le terrain semble positive : « malgré l’absence de données récentes, nous observons une augmentation visible de la superficie des mangroves chaque année. Les efforts de restauration commencent à porter leurs fruits. Les mangroves sont des écosystèmes qui sont dynamiques ». « Les mangroves ont repris », affirme le Commandant.
Selon une étude confidentielle réalisée en 2024 pour « Déterminer les valeurs des services des écosystèmes des mangroves dans la Réserve de Biosphère transfrontière Togo –Bénin », les mangroves togolaises ont en réalité perdu 7,33 % de leur superficie en 26 ans; mais cet estimé reste officieux. Raison: le rapport de cette étude dont nous avons réussi à avoir la copie n’a pas encore été validé pour être divulgué.
Tout compte fait, cette étude montre qu’entre 1997 et 2023, les zones de mangrove de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Mono (RBTM) au Togo ont perdu plus de 11 hectares de surface. Selon les données, leur superficie est passée de 155,127 ha (0,191 %) à 143,750 ha (0,177 %).
-Insérer un graphique : https://public.flourish.studio/visualisation/24661630/(crédit : PCK/TRP&De CIVE)
Interprétation du graphique : Si l’on croise les données du rapport officiel de l’UICN (2020) avec les résultats confidentiels de l’étude conduite en 2024, il apparaît qu’entre 2020 et 2023, les mangroves togolaises ont connu un rebond. En trois ans, leur superficie a augmenté de 31,22 hectares, soit une croissance relative de 27,75 %. Une dynamique qui semble traduire les premiers effets des efforts de restauration engagés ces dernières années.
Alors que le Togo peine à structurer une réponse efficace, la situation en République Démocratique du Congo (RDC) illustre une autre facette tout aussi préoccupante de la crise des mangroves en Afrique de l’Ouest et Centrale. Pendant qu’au Togo, elles suffoquent sous le poids des sabots, dans les zones pétrolières de la RDC, le torchage, la coupe de bois et le braconnage menacent les mangroves : chaleur et pollution, plongée dans une destruction lente d’un écosystème vital du parc marin de Moanda.
Moanda étouffe ses mangroves
Située en Afrique centrale[10], avec ses énormes potentialités en matière de biodiversité, la République démocratique du Congo (RDC) est le deuxième pays au monde en terme de forêt tropicale et abritant une faune et une flore exceptionnelles. Elle partage les forêts du bassin du Congo avec cinq pays (le Cameroun, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République centrafricaine) dont elle occupe environ 60%.
Les richesses naturelles de la RDC offrent des opportunités de développement durable, mais sont également soumises à des menaces telles que la déforestation et le braconnage. C’est l’une des raisons pour lesquelles sa population croupit dans la pauvreté. Face à ces enjeux, le parc marin des Mangroves, un écosystème abritant 3000 espèces de poissons, contribuant au maintien de la biodiversité tropicale, n’est pas du tout épargné.
Classé parc marin depuis le 02 mai 1992 et reconnu aire protégée en 1996 par la Convention de Ramsar, le Parc Marin des Mangroves de Moanda s’étend sur 768 Km2 soit 76000 ha. Il est situé à l’ouest de la RDC, avec 20% de son étendue dans l’océan atlantique, où se situe l’enclave angolaise du Cabinda. Ce parc revêt d’une importance écologique capitale du littoral atlantique congolais. Unique et abritant une biodiversité exceptionnelle, ce site, depuis trois décennies après sa création, subit des menaces persistantes parmi lesquelles figurent le torchage à outrance des exploitants pétroliers dont les angolais ainsi que le groupe PERENCO, mettant en danger la survie de ces mangroves, tout en menaçant les espèces aquatiques.
Une destruction faite sous l’œil impuissant de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)/Moanda. « Faute de moyens financiers, nous ne parvenons pas à empêcher la violation de cette aire protégée. 22 éco gardes pour 76 000 ha, c’est vraiment difficile. Les braconniers sont armés et nous ne parvenons pas à contrôler d’autres situations », alerte l’Inspecteur Ngieli Mpayi, Chef de Site Adjoint du parc marin des Mangroves.
Et pourtant, le pays aurait déjà perdu entre 30 et 50% de ses mangroves sous la pression humaine, rapportent des organisations de la société civile. Une enquête de CORAP (Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l’action publique) révèle que les activités humaines exercent une pression croissante sur les 45 km du littoral atlantique, entraînant la destruction des habitats marins et la disparition des ressources halieutiques.

« Ce parc était plus dense qu’aujourd’hui », confie une habitante inquiète. « Des maisons y poussent du jour au lendemain. Pour construire, les riverains se mettent à brûler des étendues. On ne comprend pas ce qui se passe. Allez voir du côté du village Lemvo. Si rien n’est fait, ils vont tout raser pour construire, et cela se fait au vu et au su de tous », s’indigne-t-elle. Une indignation partagée par plus d’un à Monda. « Ce sont les autorités, surtout militaires qui achètent ces étendues pour construire. Qui peut s’y opposer ? l’autorité compétente est pourtant au courant de tout ! » Renseigne une source digne de foi, sur place à Moanda.
Une étude de Joyce Mbiya Kangudia, publiée en 2024, intitulée ⁸Etude de la dynamique spatio-temporelle du Parc Marin des Mangroves (PMM) à la Côte Atlantique de Muanda, RD Congo apporte une réponse spécifique et localisée à la question de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Cette étude met en lumière la régression de la classe mangrove pendant la période de 2023 à 2022 et permet de corroborer l’hypothèse d’une croissante démographique importante, accentuant la pression sur cet écosystème. Les résultats approuvent des pertes de superficie dans la classe mangrove provenant des diverses activités humaines comme la coupe des bois énergie, l’urbanisation, les activités minières exécutées en synergies humaines et dont l’impact a été clarifié par l’identification et la classification des transformations spatiales.
__________________________________
⁸ Analyse intitulée : « Etude de la dynamique spatio-temporelle du Parc Marin des Mangroves (PMM) à la Côte Atlantique de Muanda, RDCongo », publiée par Joyce Mbiya Kangudia, en 2024

Dans la foulée, le braconnage reste également présent, notamment celui des singes et du lamentin, une espèce emblématique menacée. Selon l’Inspecteur Ngieli Mpayi, la préservation des mangroves est vitale non seulement pour la faune qu’elles abritent, mais aussi pour leur capacité exceptionnelle à capter le carbone. Leur destruction libère quatre fois plus de carbone que la coupe d’une forêt terrestre équivalente. « Nous attrapons parfois les braconniers, mais ils sont libérés car ils œuvrent en complicité avec des autorités », précise-t-il.
PERENCO et l’ombre de la complicité

Les mangroves du parc marin de Moanda, à l’ouest, suffoquent sous les activités pétrolières. En novembre 2022, les médias et consortium d’investigation Disclose, EIF et Investigate Europe ont révélé qu’en RDC[11] la société franco-britannique PERENCO, exploitant une dizaine de gisements dans la région, mettait en péril cet écosystème pourtant classé zone humide d’importance internationale.
Vulnérables aux phénomènes anthropiques, les mangroves de ce parc marin sont détruites également par l’exploitation non conventionnelle du pétrole. « Même les Angolais vendeurs de pétrole détruisent cette ressource. Ils exploitent la nuit, vers Cabinda, à la frontière de l’Angola. Et le principe pollueur-payeur n’est pas appliqué », peste une riveraine. Plusieurs sources affirment cette exploitation illégale de nuit, par des individus venus d’Angola, près de Cabinda.
Les ressources pétrolières situées dans la Zone d’Intérêt Commun (ZIC), au large des côtes de la RDC et de l’Angola, dans l’océan atlantique peuvent constituer un enjeu de tension entre l’Angola et la RDC. Exploité seul par l’Angola, ces gisements partagés par les deux pays, ont été au cœur d’une rencontre intervenue entre le président angolais João Lourenço et son homologue de la RDC Félix Tshisekedi en 2020 à Benguela en Angola. Au cours de ce tête-à-tête les deux chefs d’Etats avaient « exprimé leur intention d’exploiter conjointement ces ressources pétrolières », avait informé, aa.com[12].
Cette situation réduit les moyens de subsistance des populations locales et aggrave la pauvreté de la même manière que la précarité de la population est aggravée par le torchage gazier de PERENCO et le trafic pétrolier. Cette technique consiste à brûler le gaz libérélors de l’extraction du pétrole. Interdite depuis 2015, cette pratique libère, lors de l’extraction du pétrole, d’importantes quantités de méthane dans l’atmosphère. Selon l’ONG Skytruth, 58 sites de torchage ont été identifiés entre 2012 et 2021 dans ou près du parc marin « un écosystème protégé fait d’arbres tropicaux et de marais qui hébergent lamantins, hippopotames, singes et tortues ». Indique l’enquête.
Deux milliards de mètres cubes de méthane auraient été rejetés. En 2021, l’empreinte carbone de PERENCO équivalait à celle de 21 millions de Congolais.
« Le méthane est considéré comme l’une des principales sources du réchauffement climatique après le dioxyde de carbone. A Moanda, en tout cas, la pratique n’a rien d’exceptionnel : depuis près d’une décennie, les torchères brûlent sans relâche, jour et nuit », révèle-t-elle.
Dans un rapport publié l’année dernière, la Banque mondiale a alerté que le torchage de gaz a atteint un niveau record en 2024. « Les volumes de gaz torché ont fortement augmenté pour la deuxième année consécutive, entraînant environ 63 milliards de dollars de pertes d’énergie et compromettant les efforts de gestion des émissions et de renforcement de la sécurité énergétique et de l’accès à l’énergie », alerte la Banque mondiale. « Le torchage, qui consiste à brûler le gaz naturel associé à l’extraction du pétrole, a atteint 151 milliards de mètres cubes en 2024, soit 3 milliards de plus que l’année précédente, et son niveau le plus élevé depuis près de deux décennies »[13].
Pire encore, des soupçons de complicité pèsent sur l’ICCN, chargée de la gestion du parc. Une source locale et proche de cette société affirme que PERENCO verserait une somme d’argent à l’ICCN pour contribuer à la gestion du parc. Une somme qui varie entre 50 000 et 100 000 dollars par mois. Pourtant, l’ICCN Moanda est confronté à un manque de moyens de subsistance criant. Contacté à ce sujet, la Direction Générale de l’ICCN à Kinshasa nous a mis en attente pour se prononcer.
La vente du charbon de bois, un commerce plus en vogue au Kongo central n’épargne pas les mangroves

La RDC joue un rôle crucial dans la conservation de la biodiversité mondiale, notamment en raison de l’importance de ses forêts tropicales. Faute d’alternatives, les riverains des parcs en général et ceux des mangroves en particulier s’adonnent à la coupe de bois énergie pour assurer leur survie. Pour ce qui est des mangroves, elles sont coupées afin d’en faire le commerce du charbon, très en vogue dans la province du Kongo central. D’où, la nécessité de sensibiliser les populations locales à l’importance de la biodiversité et de les impliquer dans les efforts de conservation. Une charge que portent les ONG tant locales qu’internationales.
C’est le cas de CRI, une ONG de droit congolais, experte en gestion des ressources naturelles, droits fonciers, forestiers et du développement intégré. Cette ONG a entrepris depuis 2023, des actions concertées avec les riverains du parc marin des mangroves. Ces actions visent l’élaboration d’une stratégie communautaire de conservation des aires protégées.
« Nous avons appuyé le Parc dans le sens d’organiser des réunions de consultation avec les communautés à travers les représentants, les femmes et jeunes, les pêcheurs et autres qui exercent les pressions sur cet écosystème. Nous avons fait en sorte qu’ils soient sensibilisés sur la stratégie, présentant leurs difficultés et après ils ont donné leurs suggestions qui devraient être pris en compte dans la nouvelle stratégie », a déclaré Landry Kuma Kuma, adjoint au responsable du programme à CRI.
La mise en place de stratégies de développement durable, la promotion de l’agriculture respectueuse de l’environnement, la lutte contre le braconnage et la gestion durable des forêts sont essentielles pour préserver la biodiversité congolaise et ses nombreux bénéfices ; car l’augmentation de la population et la demande croissante en ressources naturelles exercent une pression supplémentaire sur la biodiversité.
« Ces pratiques, bien que destructrices, sont vécues comme des stratégies de survie par des habitants qui revendiquent une présence historique sur ces terres, bien antérieure à la création des zones de conservation. En parallèle, les agents des aires protégées, chargés de faire appliquer les règles de préservation, se retrouvent régulièrement en situation de confrontation avec ces usagers, créant un climat de tension et d’exclusion », confie l’ambassadrice de la Belgique en RDC, Roxane de Biderling.
Face à la dégradation alarmante du parc marin des Mangroves, la Coopération belge, à travers ULB Coopération, une ONG de l’Université Libre de Bruxelles installée à Moanda depuis quelques années, s’est engagée à accompagner les communautés locales dans des actions concrètes de régénération des Mangroves.

Pour atteindre ses objectifs, ULB Coopération mise sur l’implication des populations riveraines en leur proposant des alternatives durables à l’exploitation des mangroves. À Kimongo Wolo, un village situé dans le secteur d’Asolongo, un champ communautaire a été mis en place. Il permet aux habitants d’apprendre des techniques de culture vivrière et de fertilisation des sols, dans une biotope riche, entourée de baobabs. Le village joue un rôle de zone tampon entre le milieu terrestre et le parc marin des mangroves.
« Le rôle du champ-école est de répondre aux problèmes agricoles que rencontraient ces communautés. Depuis trois ans, il apporte des solutions agro écologiques concrètes. Ces alternatives permettent aux habitants de délaisser la coupe des mangroves, autrefois leur principale activité pour produire du charbon de bois. Aujourd’hui, occupés par l’agriculture vivrière, ils ont moins de temps pour exploiter la mangrove et disposent de nourriture à consommer et à vendre. Mais les convaincre n’a pas été facile », explique Joseph Mayala, animateur du champ-école pour ULB Coopération.
Ce projet, officiellement lancé en janvier 2022 avec un coût de 81372 Euros pour une durée de cinq ans, prendra fin en décembre 2026. Il cible sept villages. L’initiative a montré que la sensibilisation intensive des communautés vivant autour du parc marin, combinée à la création d’activités génératrices de revenus, peut significativement réduire la pression exercée sur les mangroves et favoriser leur restauration. L’objectif est de mettre fin à la dépendance au charbon de bois, activité historiquement dominante dans cette région.
« Les opérations de reboisement sont menées parallèlement à l’introduction d’activités économiques alternatives, jugées plus rentables que la production de charbon. Il est également important de mentionner l’existence de grandes plantations d’acacias dans la région, capables de fournir du bois aux marchés urbains de Boma, Matadi et Kinshasa, réduisant ainsi la dépendance à l’exploitation illégale des forêts naturelles », souligne l’ambassadrice Roxane de Biderling.
Et, à côté de tous ces problèmes, se pose celui de la construction du port en eau profonde de Banana. Ce port commercial développé sur la rive nord de l’embouchure du Congo, dans une baie qui s’ouvre vers le fleuve, à l’isthme sablonneux de Banana. « Le Port de Banana, qui est construit à cet endroit aura un impact négatif sur les mangroves car les activités de l’exploitation du port, vont causer la destruction des écosystèmes du parc. Je crois que le gouvernement devrait demander l’avis des Experts avant d’entamer ces travaux. » S’indigne l’inspecteur Ngieli.
L’intensification des activités socioéconomiques couplées à l’accroissement démographique accentue la dégradation des écosystèmes marqués par la régression des classes Mangroves et de l’eau, tandis que la classe sol nu a connu un processus de progression. L’état dans lequel se trouvent les mangroves à ce jour devrait pousser les décideurs politiques et les gestionnaires territoriales à mettre en place des actions concrètes pour une gestion durable de cette aire protégée.
Cet article est rédigé par Pierre-Claver Kuvo (Togo) & Sarah Mangaza (RD Congo) avec le soutien de la CENOZO (Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest) dans le cadre de la phase 3 du projet OCRI (Open Climate Reporting Initiative).
[1]https://www.ramsar.org/fr/news/togo-inscrit-nouvelles-zones-humides dimportance-internationale
[2] ASSOCIATION TOGOLAISE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE, Programme Marin et Côtier (MACO) de l’UICN. Projet PAPBio C1-Mangroves « de Gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin. Diagnostic prospectif du paysage prioritaire de conservation du mono volta (TOGO), juin 2020, p. 12.
[3] https://www.facebook.com/61556356678689/posts/la-mangrove-est-un-%C3%A9cosyst%C3%A8me-vital-%C3%A0-la-fois-barri%C3%A8re-naturelle-contre-l%C3%A9rosion/122247947138211889/
[4] FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), cartographie des acteurs et des écosystèmes de mangrove du littoral togolais, Lomé, 2020, p. 35.
[5]https://www.mangrovealliance.org/wp-content/uploads/2022/02/The-State-of-the-Worlds-Mangroves-French.pdf, p.11.
[6] https://tg.chm-cbd.net/fr/news/r4c-togoprojet-secours-restauration-lecosysteme-mangrove-togo
[7] https://www.carenews.com/tpsf-travaux-publics-sans-frontieres/news/degradation-de-la-mangrove-du-togo
[8] Fiche d’information du document d’évaluation du projet Togo projet régional d’investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l’ouest – projet Waca – Togo document d’évaluation du projet région Afrique
[9] https://tg.chm-cbd.net/fr/news/r4c-togoprojet-secours-restauration-lecosysteme-mangrove-togo
[10] « Le taux de perte des mangroves en Afrique centrale atteint 1,77 % chaque année depuis 2000. On estime qu’en seulement dix ans, près de 77 100 hectares de ces importants puits de carbone ont été détruits dans cette région », in PNUE, Mangroves d’afrique centrale : des puits de carbone aux multiples atouts une évaluation pour la redd+ https://www.uncclearn.org/wp content/uploads/library/mangroves_dafrique_centrale_resume_executif_191935.pdf
[11] https://disclose.ngo/fr/article/perenco-revelations-sur-les-ravages-du-groupe-petrolier-en-rdc
[12] https://www.aa.com.tr/fr/afrique/la-rdc-et-langola-veulent-exploiter-conjointement-le-p%C3%A9trole-de-l-atlantique-/1693574
[13]https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2025/07/18/global-gas-flaring-hits-highest-level-since-2007-undermining-energy-security-access-and-emissions-goals?intcid=ecr_hp_sidekick2_fr_ext