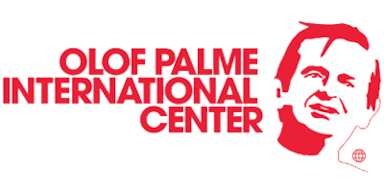Au cœur de l’Afrique, la République Démocratique du Congo (RDC) abrite la plus grande forêt tropicale du continent, deuxième « poumon vert » de la planète après l’Amazonie. Ses paysages (forêts denses, savanes, rivières et zones humides) renferment une biodiversité exceptionnelle et des services écosystémiques vitaux pour la planète. Pourtant, ce patrimoine est menacé : déforestation, exploitation minière, braconnage et changement climatique fragilisent chaque année un peu plus les écosystèmes et les communautés qui en dépendent.
Une nouvelle voie pour protéger la biodiversité congolaise
Face à cette urgence, la RDC s’est engagée, lors de la COP15 de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), à mettre en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal (CMB-KM) et à atteindre l’ambitieux objectif « 30×30 », c’est-à-dire protéger 30 % de ses terres et de ses eaux d’ici 2030. Mais comment élargir les aires protégées dans un pays où les ressources sont sous pression et où les communautés locales vivent directement des forêts ? C’est ici qu’interviennent les Autres Mesures Efficaces de Conservation par zone (AMEC), un concept encore peu connu mais porteur d’espoir.
Qu’est-ce qu’une AMEC ?
Introduites en 2010 dans le cadre de la CDB, les AMEC désignent des zones géographiques qui, sans être formellement classées comme aires protégées, contribuent durablement à la conservation in situ de la biodiversité. Elles reconnaissent et valorisent des espaces où la nature est préservée grâce à des pratiques communautaires, culturelles ou coutumières : forêts gérées par des communautés, zones sacrées, réserves coutumières, paysages agroforestiers.
L’intérêt majeur des AMEC est de réconcilier conservation et réalités locales. Contrairement aux parcs nationaux stricts, elles permettent aux communautés de continuer à utiliser leurs terres et leurs ressources, tout en maintenant les fonctions écologiques. Elles s’inscrivent dans une vision inclusive qui reconnaît les droits fonciers coutumiers, les savoirs traditionnels et les initiatives locales.
Entre ambitions mondiales et réalités nationales
En RDC, plusieurs initiatives existent déjà et pourraient être reconnues comme AMEC. Les plus emblématiques sont :
Les Concessions Forestières des Communautés Locales (CFCL) : des forêts attribuées gratuitement et perpétuellement aux communautés locales, qui en assurent la gestion durable pour leurs besoins vitaux (produits forestiers, bois, chasse de subsistance).
Les Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC) : des sites où les peuples autochtones et les communautés locales préservent la biodiversité par leurs pratiques culturelles et spirituelles.
Les réserves communautaires : des zones gérées directement par les communautés pour protéger la faune et la flore.
Ces initiatives, souvent portées par les Peuples Autochtones Pygmées (PAP) et les Communautés Locales (CL), contribuent déjà à la conservation des forêts congolaises. Leur reconnaissance en tant qu’AMEC permettrait de les inscrire dans les engagements internationaux de la RDC tout en sécurisant les droits des communautés.
Un processus déjà enclenche
Depuis 2022, le gouvernement congolais et ses partenaires techniques et financiers comme l’UICN, GIZ, Rights and Resources Initiative et Rainforest Foundation Norway) ont multiplié les actions pour structurer ce nouveau cadre.
Mai 2023 : un dialogue national fondateur
Le ministère de l’Environnement et Développement durable (MEDD), en collaboration avec l’UICN, a organisé à Kinshasa un dialogue national sur la mise en œuvre de la cible 3 du CMB-KM. Ce rendez-vous a permis de capitaliser les acquis, de partager des expériences et d’identifier des pratiques écosystémiques capables de contribuer à l’objectif 30×30.
Une étude sur les modes de gouvernance
À la suite de ce dialogue, l’UICN a conduit une étude approfondie des sites potentiellement éligibles comme AMEC. L’objectif : dresser le profil des aires de conservation existantes, évaluer leur valeur écologique et comprendre les modèles de gouvernance (communautaire, coutumier, mixte). Les résultats confirment que les APAC, CFCL et réserves communautaires jouent déjà un rôle déterminant dans la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques.
La Liste verte de l’UICN
Depuis 2023, la RDC participe aussi au processus de la Liste verte, un mécanisme d’évaluation de la qualité de gestion des aires protégées et conservées. Les AMEC identifiées seront progressivement intégrées à cette évaluation, renforçant leur crédibilité internationale.
Vers une stratégie nationale
En avril 2024, le MEDD a lancé l’élaboration d’une Stratégie nationale de la conservation de la nature en dehors des aires protégées traditionnelles, en partenariat avec l’Alliance Nationale d’Appui et de Promotion des APAC (ANAPAC-RDC) et plusieurs bailleurs. Une « Task force 30×30 » a également été mise en place pour harmoniser les interventions et définir une feuille de route commune.
Des avancées encourageantes… mais des défis de taille
Malgré cette dynamique, la reconnaissance officielle des AMEC en RDC reste semée d’embûches.
Un cadre juridique incomplet
Il n’existe pas encore de loi spécifique encadrant les AMEC. La loi congolaise sur la conservation de la nature fixe un objectif de protection de 15 %, bien en-deçà du 30 % visé par le CMB-KM. L’absence de dispositions claires retarde la reconnaissance des initiatives communautaires et crée une insécurité juridique pour les communautés.
Une gouvernance fragmentée
De nombreux acteurs comme les ministères, ONG internationales, bailleurs et organisations communautaires interviennent sur le terrain. Mais la coordination reste faible, entraînant des chevauchements d’initiatives et une dispersion des financements.
Des tensions autour des droits fonciers
Certaines communautés craignent qu’une reconnaissance officielle ne conduise à des restrictions d’usage ou à des expropriations déguisées. La chasse de subsistance, essentielle à la survie de nombreuses familles, reste difficile à encadrer dans plusieurs zones.
Des moyens limités pour le suivi
Identifier, cartographier et évaluer les AMEC nécessite des ressources techniques et financières importantes : systèmes de suivi de la biodiversité, formation des communautés, collecte de données fiables.
Des communautés déjà en première ligne
Malgré ces obstacles, des centaines de communautés continuent de gérer leurs forêts selon des pratiques durables. Depuis 2017, plus de 200 concessions forestières communautaires ont déjà été attribuées, et une quarantaine d’autres sont en cours de processus. Ces espaces, bien que non classés officiellement, constituent de véritables remparts contre la déforestation et des laboratoires de gouvernance inclusive.
Dans certaines APAC, les coutumes locales jouent un rôle essentiel : certains sites sacrés, considérés comme le « lieu des ancêtres », sont naturellement protégés des activités destructrices. Ces pratiques culturelles, souvent invisibles aux yeux des décideurs, démontrent que la conservation peut s’appuyer sur les traditions autant que sur les politiques.
Des perspectives prometteuses
Pour que les AMEC deviennent un pilier de la stratégie nationale, plusieurs étapes clés s’imposent :
Adopter une législation spécifique qui reconnaisse les AMEC et intègre l’objectif 30×30 dans le droit national.
Renforcer la gouvernance inclusive, en associant étroitement les communautés, les provinces et les ministères sectoriels à la planification et à la mise en œuvre.

Sécuriser les droits fonciers des communautés afin d’éviter l’accaparement des terres ou leur conversion en concessions minières ou forestières industrielles.
Assurer un financement pérenne pour le suivi écologique, la formation et la valorisation économique des services écosystémiques (écotourisme, produits forestiers non ligneux, crédits carbone).
Intégrer les AMEC dans les plans provinciaux et les bases de données nationales et internationales afin de donner une visibilité aux efforts locaux.
Une opportunité à ne pas manquer
La reconnaissance des AMEC représente bien plus qu’un outil technique pour atteindre l’objectif 30×30. C’est une opportunité historique pour repenser la conservation en RDC : une conservation qui respecte les droits des peuples autochtones, valorise les savoirs locaux et place les communautés au cœur des solutions.
Alors que le monde cherche des réponses à la crise climatique et à l’érosion de la biodiversité, la RDC a la possibilité de démontrer que protéger la nature et soutenir les populations ne sont pas des objectifs contradictoires, mais les deux faces d’un même projet de société. Le succès de ce pari dépendra de la capacité du pays à traduire ses engagements internationaux en politiques concrètes, financées et partagées.
La dynamique est lancée. Reste maintenant à transformer l’élan des dialogues, des études et des stratégies en actions visibles sur le terrain, pour que les forêts congolaises, gardiennes de la vie, puissent continuer à respirer pour le monde entier.
Dr. Batachoka Mastaki Daniel
Références
Convention sur la diversité biologique (CDB). (2010). Décision X/31 sur les aires protégées. https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12297
Alves-Pinto, H. N., et al. (2021). Other Effective Area-Based Conservation Measures: Progress, Promise and Challenges. Parks Journal, 27(1), 63–76. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2021.PARKS-27-1.HNP.en
Ministère de l’Environnement et Développement durable (MEDD-RDC). (2023). Dialogue national sur la cible 3 du Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. https://medd.gouv.cd
GeoCFCL. (2024). Base de données des concessions forestières des communautés locales en RDC. https://rdc.geocfcl.org/applications/