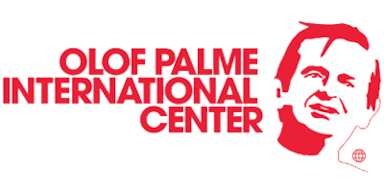Un projet unique en son genre met en lumière les préoccupations mondiales concernant les violations des droits de l’homme, l’escalade des menaces et le changement climatique catastrophique Les hôtes des négociations sur le climat Cop30 qui se tiendront le mois prochain à Belém se sont engagés à faire de ce sommet le premier où les peuples autochtones joueront un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. Mais une nouvelle enquête majeure montre que les peuples autochtones des forêts tropicales du monde entier mènent déjà un combat sur plusieurs fronts. Ils sont confrontés à des violations de leurs droits, à une détérioration de leur accès aux services essentiels et à des menaces croissantes pour leurs moyens de subsistance.
Dans le cadre d’un projet journalistique unique en son genre, nous avons interrogé 100 autochtones issus des pays possédant les plus grandes forêts tropicales afin d’évaluer leur qualité de vie et les dangers auxquels ils sont confrontés en tant que défenseurs de première ligne du climat. Nous avons principalement discuté avec des personnes originaires du Brésil, du Pérou, de la République démocratique du Congo (RDC), d’Indonésie, de Bolivie, de Colombie et du Venezuela, et la majorité d’entre elles ont déclaré que leur situation s’était considérablement détériorée au cours des dix dernières années.
Les deux tiers des personnes interrogées, dont la majorité des répondants du Brésil, de Bolivie, du Pérou, d’Indonésie et du Venezuela, ont déclaré que leur gouvernement ne respectait pas leurs droits. Plusieurs ont souligné la faiblesse de l’application des lois destinées à les protéger.
Au Brésil, plusieurs personnes ont également salué les efforts du président Lula et la nomination historique de Sônia Guajajara au poste de ministre des Peuples autochtones, qui, selon elles, leur a donné un sentiment d’espoir et d’autonomie.
À l’échelle mondiale, cependant, plus de la moitié ont déclaré que leur vie et leurs moyens de subsistance étaient déjà affectés par le changement climatique, citant les inondations, les sécheresses, les incendies de forêt, les changements de saisons et les températures extrêmes.
Commentant nos conclusions, Fany Kuiru Castro, présidente de l’Organisme de coordination des organisations autochtones du bassin amazonien, a déclaré : « La situation est grave, extrêmement grave. »
Elle a ajouté qu’il existe en Amazonie des groupes illégaux qui criminalisent, persécutent et tuent les dirigeants autochtones et les personnes qui défendent leurs territoires, et que les dangers sont aggravés par la crise climatique.
Chris Chapman, conseiller d’Amnesty International sur les droits des peuples autochtones, a déclaré que nos conclusions étaient « tout à fait conformes aux recherches mondiales menées par Amnesty International sur les peuples autochtones dépendants de la forêt dont les droits ont été violés ».
Il a ajouté : « On peut affirmer que nous ne parviendrons pas à inverser cette crise tant que nous n’aurons pas tous, en tant que communauté mondiale, cherché à établir une relation plus saine avec la nature. »
100 voix autochtones
En collaboration avec El País, MidiaNINJA, Tempo et La Región, nous avons posé les mêmes 10 questions à 100 autochtones qui ont été interviewés en personne, sur Zoom ou via WhatsApp. Les questions couvraient un large éventail de sujets, allant des menaces auxquelles ils sont confrontés à leur niveau d’accès à la nourriture, en passant par ce que la forêt signifie pour eux.
Environ deux tiers ont déclaré que leur santé et leur capacité à trouver ou à cultiver de la nourriture avaient souffert. Près de la moitié ont déclaré que l’accès à l’eau s’était détérioré au cours de la dernière décennie.
Leo Morales, membre du peuple Taurepang, qui fait partie du groupe autochtone Pemon au Venezuela, attribue cette situation à la déforestation. « La situation empire parce que les forêts sont de plus en plus éloignées », a-t-il déclaré. « Les animaux sont de plus en plus éloignés. Ils s’enfoncent davantage dans les terres. Les rivières se sont asséchées, il n’y a plus de poissons. »
Beaucoup de ceux qui ont déclaré avoir constaté une aggravation de la déforestation – une cause majeure du changement climatique dans de nombreux pays tropicaux boisés – l’ont également liée à des secteurs spécifiques. Il s’agit notamment de l’empiètement des éleveurs de bétail et des industries extractives telles que l’exploitation minière.
Près de 60 % ont déclaré que les menaces auxquelles ils étaient confrontés s’étaient aggravées au cours des dix dernières années, citant l’exploitation minière, l’exploitation forestière, l’élevage et l’exploration des combustibles fossiles.
Des artistes de l’Amazonie brésilienne illustrent les réponses données lors des 100 entretiens. Projet coordonné par TBIJ et Mídia Ninja. Vidéo montée par Katia Pirnak
Une question citée par près d’un cinquième des personnes interrogées – toutes originaires de pays amazoniens – était la contamination au mercure. Le mercure, utilisé dans l’exploitation illégale de l’or, est hautement toxique et ses effets peuvent être dévastateurs. Les personnes interrogées ont fait part de leurs inquiétudes concernant la consommation de poisson provenant des rivières voisines, ainsi que ses effets sur les bébés à naître et les nourrissons.
« Le mercure est présent depuis des années, et nous en souffrons déjà », a déclaré Alessandra Korap Munduruku, du Brésil. « Nous savons que le lait maternel contamine les enfants, et il y a de nombreux cas de fausses couches, d’enfants qui se développent à peine. »
Certaines femmes autochtones ont également décrit les menaces de violence sexuelle de la part des hommes envahisseurs, les grossesses chez les adolescentes, la violence sexiste au sein de leur communauté et les attitudes « machistes » de leurs chefs autochtones.
Plus de 60 % des personnes interrogées ont déclaré que la santé de leur communauté s’était détériorée. Elles ont signalé l’apparition de nouvelles maladies et affections liées à des changements dans leur alimentation, ainsi que le manque de fournitures médicales et l’éloignement des établissements de santé. Deux personnes au Venezuela ont décrit des patients devant apporter leurs propres fournitures à l’hôpital.
Protéger la forêt ?
Si plusieurs traités internationaux, tels que l’Accord de Paris, font référence aux droits des autochtones, ils ne reconnaissent pas officiellement le rôle que jouent les peuples autochtones dans l’atténuation du dérèglement climatique. Des recherches montrent que les taux de destruction de la forêt – qui entraîne le rejet dans l’atmosphère du carbone stocké dans les arbres – sont systématiquement beaucoup plus faibles dans les territoires autochtones reconnus.
C’est pourquoi les peuples autochtones sont souvent décrits comme les « gardiens » des forêts tropicales. Pourtant, cette description n’est pas toujours bien accueillie.
« Je ne suis le chouchou de personne », a déclaré Wilfredo Tsamash Cabrera, membre du peuple Awajún au Pérou. « Personne ne m’a confié sa ferme pour me dire que je suis un gardien. Je ne suis pas d’accord avec ce terme. Je défends l’Amazonie parce que l’Amazonie fait partie de ma vie et que j’en fais partie. »
Dans les réponses très variées à la question « Qu’est-ce que la forêt ? », les journalistes ont entendu diverses descriptions : un temple ou une cathédrale, un membre de la famille, un supermarché, une pharmacie ou une quincaillerie.
Richard Bokatola, du peuple pygmée du territoire Kiri en RDC, l’a décrite comme son « berceau ». Des réponses caractérisant la forêt comme une figure « maternelle » ont été données par des personnes interrogées en Amazonie brésilienne et à 17 000 km de là, en Indonésie. Beaucoup ont souligné à quel point leur propre destin était lié à celui de la forêt.
Juma Xipaia, une jeune femme leader du territoire Xingu au Brésil, qui a survécu à six tentatives d’assassinat, a déclaré : « Nous ne pouvons pas nous séparer de la forêt. C’est une seule et même chose… Il est impossible que l’impact sur la vie de mon peuple n’ait pas d’impact sur la forêt, ou vice versa. »
Certains, cependant, se sont sentis valorisés par la reconnaissance du fait qu’ils protègent et préservent les forêts. Beaucoup ont même déclaré qu’ils étaient la solution à la crise climatique. Mais ils ont souligné la nécessité d’un soutien significatif sous la forme d’engagements internationaux, y compris un financement direct, afin de renforcer la défense de leurs vies et de leurs terres.
D’autres, cependant, ont estimé que cette responsabilité était injustement lourde. Nardy Velasco Vargas, du peuple Chiquitano en Bolivie, a déclaré : « Il semble que nous, les peuples autochtones, soyons laissés seuls face à la lourde tâche de sauver la planète. »
Interviews by: Grace Murray, Flávia Milhorance, Maria Mónica Monsalve, Rocío Lloret Céspedes, Clavel Rangel, Jack Lo Lau, Jennifer Labarre, Midia NINJA, Krisna Adhi, Katia Pirnak, Andre Lopes, Paul Eccles, Irsyan Hakim, Fachri Hamzah, and Yuni Rohmawati.
Main image: Oliver Kemp/TBIJ
Lead reporter: Grace Murray
Environment editor: Rob Soutar
Deputy editor: Chrissie Giles
Editor: Franz Wild
Production editor: Alex Hess
Fact checker: Ero Partsakoulaki