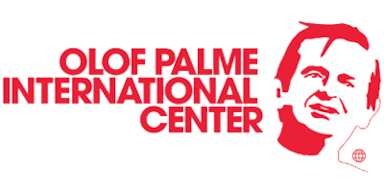Après l’impasse des négociations à Cali en novembre 2024, la seconde partie de la COP16 sur la biodiversité s’est achevée à Rome le 27 février 2025 avec un accord sur la mobilisation des ressources financières. Cette avancée marque un tournant dans les discussions internationales sur la protection de la biodiversité, un enjeu majeur pour la planète.
Une avancée pour le multilatéralisme environnemental
Dans un contexte où le multilatéralisme est fragilisé, les États parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) sont parvenus à un compromis sur le financement des actions visant à enrayer l’effondrement de la biodiversité. L’objectif est de mobiliser les 200 milliards de dollars annuels nécessaires d’ici 2030, comme fixé lors de la COP15 à Montréal en 2022.
Lors de la COP16 de Cali, des avancées avaient été enregistrées sur le partage des bénéfices issus des ressources génétiques numérisées (DSI) et sur la reconnaissance des peuples autochtones avec la création d’une instance permanente. Cependant, la question du financement était restée en suspens en raison des divergences entre les pays du Sud, qui souhaitaient un nouveau mécanisme financier, et les nations du Nord, qui privilégiaient l’utilisation des instruments existants, notamment le Fonds-cadre mondial pour la biodiversité (GBFF) créé sous l’égide du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).
À Rome, les négociations ont permis de surmonter ces désaccords en adoptant une approche combinée. Un engagement a été pris pour établir des mécanismes financiers conformes aux textes de la Convention tout en optimisant les dispositifs existants. Une feuille de route a été définie pour les COP17, 18 et 19, identifiant un large éventail d’instruments de financement, aussi bien publics que privés.
Une mobilisation financière élargie et structurée
Les discussions ont également mis en lumière les difficultés d’accès aux financements pour les pays en développement, dues à la fragmentation des sources de financement. La présidence colombienne avait proposé la création d’un instrument mondial de financement structurant les besoins financiers des pays du Sud. Finalement, l’accord trouvé repose sur un double engagement : d’une part, renforcer la mobilisation des ressources à tous les niveaux – national, international, public et privé – et, d’autre part, mener une évaluation des dispositifs financiers existants pour améliorer leur efficacité.
Agnès Pannier-Runacher, ministre française de la Transition écologique, s’est félicitée de cet accord, soulignant qu’il ne prévoit pas la création d’un fonds supplémentaire, évitant ainsi une dispersion des ressources. Elle a également insisté sur l’élargissement de la base des contributeurs, encourageant les économies émergentes à participer davantage au financement mondial de la biodiversité.
Un cadre de suivi renforcé pour garantir les engagements
Un autre point clé des négociations a porté sur le suivi des engagements pris dans le cadre du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal. Les représentants des États ont adopté des critères communs pour mesurer les progrès réalisés et intégrer les contributions d’acteurs non gouvernementaux, tels que les collectivités territoriales, les peuples autochtones et les entreprises privées.
Le bilan mondial de la mise en œuvre de ces engagements sera réalisé en 2026 lors de la COP17 en Arménie. Cette évaluation est essentielle pour éviter la répétition de l’échec des objectifs d’Aichi, définis en 2010, dont l’absence de mécanisme de suivi avait compromis l’application. Toutefois, un défi de taille demeure : à ce jour, seuls 46 pays ont soumis leur stratégie ou plan d’action national, alors que 150 États sont encore attendus pour publier leurs engagements actualisés.
Le Fonds Cali, une initiative inédite pour le partage des bénéfices
L’un des résultats notables de cette COP16 est l’officialisation du Fonds Cali, une initiative dédiée au partage des bénéfices issus des ressources génétiques numérisées. Financé par des entreprises opérant dans les secteurs agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique, ce fonds vise à redistribuer une partie des revenus générés par l’exploitation des données génétiques des plantes et animaux originaires des pays en développement. Une partie significative des contributions, au moins 50 %, devra être allouée aux peuples autochtones et aux communautés locales, afin de soutenir la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité.
Une place encore incertaine pour l’Afrique dans le dispositif financier
Malgré cet accord, des interrogations persistent, notamment pour les pays africains. Ces derniers, et en particulier la République démocratique du Congo, avaient plaidé pour la création immédiate d’un fonds spécifique sous l’autorité de la COP. Cependant, ils devront attendre l’évaluation des outils financiers existants avant qu’une décision ne soit prise sur la création d’un nouveau fonds ou l’adaptation d’un dispositif déjà en place.
Un accord encourageant, mais des défis à relever
Si cet accord représente une avancée majeure, il ne constitue qu’une première étape. Le WWF salue une décision qui marque « un grand pas en avant pour conserver la nature, restaurer les écosystèmes et veiller à ce que le financement parvienne à ceux qui en ont le plus besoin », mais rappelle que les promesses doivent désormais se traduire en actions concrètes. L’ONG insiste notamment sur l’urgence pour les pays développés de tenir leurs engagements, notamment la contribution de 20 milliards de dollars d’ici 2025 pour soutenir les efforts mondiaux en faveur de la biodiversité.
L’adoption de cet accord à Rome offre donc une nouvelle dynamique à la mobilisation internationale pour la biodiversité, mais les prochaines COP seront décisives pour assurer la mise en œuvre effective des engagements pris.
Djiffy ELUGBA